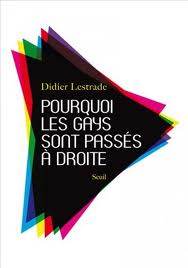Le gouvernement aura-t-il le courage politique de remettre en cause la rente des sociétés d'autoroutes ? Et si oui, de façon anecdotique ou plus symbolique ? C'est tout l'enjeu des actuelles discussions secrètes entre l'État et les sociétés concessionnaires, filiales de grands groupes du BTP (Eiffage, Vinci, Abertis) qui ont racheté les autoroutes en 2006.
Depuis des mois, la pression monte pour encadrer leurs tarifs. Une mobilisation légitimée par de récents rapports de la Cour des comptes et de l'Autorité de la concurrence. Très sévères, ils ont mis en évidence la rente exceptionnelle qu'a représentée la privatisation des autoroutes par le gouvernement Villepin.
Mais le sujet est devenu brûlant avec le fiasco de l’écotaxe. Les responsables publics ont mesuré à cette occasion qu’ils n’avaient plus de levier pour mettre en place une fiscalité écologique sur les transports routiers, en raison de la privatisation des autoroutes qui échappaient désormais totalement à leur champ d’intervention. Après son abandon définitif à l’automne, il leur a fallu aussi admettre qu’ils n’avaient plus de ressources propres pour financer le développement et l’entretien des infrastructures de transport existantes. La manne des autoroutes, auparavant utilisée, s’est envolée depuis longtemps vers le privé.
La semaine dernière, la pression est encore montée d'un cran. Dans une lettre à Manuel Valls, 152 députés (plus de la moitié des élus PS au Palais-Bourbon, une mobilisation rare par son ampleur) ont réclamé un schéma bien plus ambitieux : le « rachat des contrats de concessions autoroutières ». Autrement dit, une reprise en main temporaire des concessions par un établissement public. Le temps (un an, proposent les députés) de renégocier de nouveaux contrats avec les sociétés d'autoroutes, financièrement plus favorables à l'État, permettant de mieux encadrer l'évolution future des péages autoroutiers et de dégager des ressources pour financer les infrastructures de transport. Dans le scénario proposé, seule la propriété des infrastructures reviendrait au public, la gestion serait laissée au privé.
Mercredi 17 décembre, le président de la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, Jean-Paul Chanteguet, a remis un rapport qui plaide pour cette piste. Il plaide pour une « renégociation intégrale » avec les sociétés « sur la base de cahiers des charges refondus ». « Il est urgent que le gouvernement notifie aux concessionnaires sa volonté de rupture, pour bâtir un nouveau système au cours de l’année 2015, avec au plus tard une entrée en vigueur au 1er janvier 2016 », insiste le rapport. « Les sociétés d'autoroutes ne cessent d'affirmer qu'il n'y a pas d'alternatives au schéma actuel. Ce rapport prouve le contraire », assure un proche du député.
Fait rare, Chanteguet peut se prévaloir du soutien de tous les présidents de commissions de l'Assemblée et du patron des députés PS, Bruno Le Roux, un proche de François Hollande. Ainsi que d'élus de toutes les franges du PS, des anciens ministres "frondeurs" (Delphine Batho, Aurélie Filippetti ou Benoît Hamon) à Christophe Caresche, sur l'aile droite du PS. « Les intérêts de l'État n'ont pas été correctement préservés par cette privatisation et cette solution tient la route », dit ce dernier.
Cette piste est soutenue par le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, qui exige un débat devant la représentation nationale. Elle a également l'assentiment du secrétaire d'État aux transports, Alain Vidalies. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, ne ferme pas la porte. Pour de nombreux élus socialistes, il s'agit surtout d'un « symbole » politique. « Choisir cette piste, ce serait une déclaration d'amour à la gauche », plaide un conseiller.
Officiellement, Manuel Valls défend une « remise à plat totale » des contrats. Matignon se dit ouvert à toutes les solutions. Mais en privé, le premier ministre, qui n'a pas répondu au courrier des députés, ne serait pas aussi convaincu. Ce rachat, dont le coût est estimé à au moins 22 milliards d'euros, inquiète également les services de Bercy, où l'on s'alarme des risques juridiques. Pour un gouvernement sensible aux arguments des grandes sociétés du BTP et qui campe désormais sur une ligne très pro-entreprises, un retour dans le giron public ne semble vraiment pas évident.
Ce week-end, le JDD évoquait d'ailleurs un scénario a minima : un simple gel des tarifs en 2015 (les sociétés d’autoroutes demandent une hausse de 0,54 % pour 2015), comme le réclame Ségolène Royal, et une autorité de contrôle sur les sociétés d'autoroutes, comme le prévoit la loi Macron. Une issue qui n'assurait même pas que les recommandations de l’Autorité de la concurrence soient au moins suivies. Cette dernière a préconisé, après un rapport accablant, une renégociation au moins partielle des contrats afin de mettre fin à une situation toujours en défaveur de l’État. Elle souhaite notamment un nouveau partage des profits des sociétés autoroutières afin que les usagers et l’État voient leurs intérêts mieux pris en compte. Et la création d’une véritable autorité de la régulation, contrôlant et sanctionnant tous les abus qu’elle avait pu relever.
En face, les sociétés d’autoroute sont sur le pied de guerre et mènent une offensive tous azimuts. Pour contrer les projets éventuels de dénonciation des contrats de concession, elles font monter les enchères. En cas de dénonciation des contrats, elles demandent 30 milliards d’euros de dédommagements, sans compter la reprise des dettes, alors qu'elles ont acheté les sociétés pour 14,8 milliards d’euros en 2006.
Même le gel des tarifs que souhaite le gouvernement pour 2015 leur semble insupportable. « Si les tarifs sont gelés en 2015, il faudra qu’il y ait un rattrapage et un dédommagement supplémentaire pour rupture de contrat en 2016 », ont-elles prévenu. Selon Les Échos, l'État et les sociétés d'autoroute ont signé en 2012 un accord pour une hausse programmée des péages au minimum de 1,5 % entre 2015 et 2018, afin de compenser l’augmentation de 50 % de la redevance domaniale, qui passe de 180 à 290 millions d’euros à partir de 2013. Un accord que l’on ne découvre que maintenant. Mais que les concessionnaires ont bien l’intention de faire respecter.
Les sociétés concessionnaires se veulent toutefois ouvertes à certaines propositions. Notamment celles négociées au printemps avec la direction générale des transports. Comprenant que l’argent de l’écotaxe n’arriverait pas en 2015, la direction générale des transports a en effet imaginé un autre schéma pour trouver les ressources financières permettant d'assurer l’entretien du réseau routier.
Comme Mediapart l’avait révélé à l’époque, le directeur général des infrastructures, Daniel Bursaux – qui porte une lourde responsabilité dans le détournement et le fiasco de l’écotaxe –, est allé négocier au printemps avec la commission européenne pour obtenir un allongement des concessions autoroutières, le tout sans remise en cause du contrat ni appel d’offres. En contrepartie, les sociétés concessionnaires s’engageraient à réaliser 3,5 milliards de travaux sur les réseaux routiers. Cela représenterait 11 000 emplois supplémentaires, mettent-elles en avant, sans expliquer d’où viennent ces chiffres.
Ce projet est un marché de dupes, toujours négocié dans le même sens : au détriment de l’intérêt général et de l’État. Les groupes, propriétaires des sociétés autoroutières, seraient les uniques bénéficiaires de cet engagement. D’abord, ce sont eux qui réaliseraient les chantiers puisqu’ils ont aussi des filiales spécialisées dans les travaux publics. Surtout, en compensation de leurs engagements, leur concession autoroutière serait allongée de deux à six ans. Une vraie manne : les profits annuels des sociétés d’autoroutes s’élèvent à 1,8 milliard par an. Sur six ans, cela fait plus de 10 milliards supplémentaires. À ce compte, l’État a tout intérêt à réaliser directement les travaux, en empruntant l’argent sur les marchés.
Pourtant, la solution proposée a l’air de tenter le gouvernement. Dans la plus grande discrétion, le ministère de l’économie a en effet pris, le 6 novembre, un décret contraire à toutes les dispositions sur les lois de la concurrence et la loi Sapin contre la corruption. Celui-ci prévoit d’autoriser l’allongement de la durée des concessions de travaux publics pour faire face à des travaux supplémentaires non compris dans les contrats, sans passer par la case appel d’offres. Cet allongement serait possible à chaque nouvelle demande de travaux supplémentaires.
À quoi joue l’État en prenant un tel décret, au moment où les députés s’emparent de la question des autoroutes ? Même des avocats spécialisés se sont étonnés de cette transposition partielle et embrouillée, qui revient, selon eux, à réintroduire la pratique, désormais interdite, de l’"adossement", qui consiste à faire financer une portion non rentable d’une autoroute par la prolongation de la durée d’une concession.
« Si le gouvernement emprunte cette voie, c’est la rente perpétuelle assurée pour les concessionnaires d’autoroutes », s’énerve Laurent Hecquet, fondateur de l’association Automobilité et avenir, et porte-parole d’un certain nombre de fédérations d’usagers et de transporteurs devant la commission du Sénat. Ceux-ci demandent de saisir l’occasion historique pour remettre à plat un système qui ne fonctionne plus, et qui est de plus en plus rejeté par l’opinion publique.
L’affaire est devenue si politique qu’elle a échappé à Matignon, qui l’avait déjà prise au ministère des transports et de l’environnement, et est désormais gérée directement par l’Élysée. Une réunion de travail devait s’y tenir mercredi 17 décembre pour faire le point sur le dossier, et peut-être arrêter une décision. Le gouvernement n’a de toute façon guère de temps devant lui pour prendre position. S’il veut dénoncer les contrats de concessions autoroutières, il doit le faire avant le 1er janvier.
Retour sur l’histoire d’un grand bradage d’un patrimoine national et des raisons qui devraient pousser le gouvernement à remettre tout à plat.
L’erreur des privatisations de 2006
Cela fut conduit en catimini, avec une célérité rarement vue, par la grâce d’un seul décret. Au début de 2006, Dominique de Villepin, alors premier ministre, décida d’un seul trait de plume la privatisation des autoroutes françaises. Le décret était à peine publié que le ministère des finances réalisa la vente de gré à gré des participations qu’il détenait dans les sociétés concessionnaires d’autoroutes.
En un tour de main, le géant du BTP Vinci, qui avait déjà le contrôle de Cofiroute et avait pris une participation minoritaire dans la société des Autoroutes du Sud de la France (AFS), récupéra la totalité, ainsi qu’Escota. Eiffage, autre groupe de BTP, reprit les autoroutes Paris Rhin-Rhône (APRR), dont il détenait déjà une partie et AREA. Le groupe espagnol Abertis, qui exploite des autoroutes en Espagne, hérita de la Sanef et de SAPN.
Une seule obligation fut posée par l’État à ces privatisations : les achats devaient être payés sur-le-champ en numéraire. L’État obtint ainsi 14,8 milliards d’euros. « L'ambition de mon gouvernement était de moderniser les infrastructures et de désendetter la France. Une estimation, qui était celle de tous les services de l'État et des parlementaires (...) estimait le montant à payer à un peu plus de 11 milliards d'euros (...) nous l'avons cédé à 14,8 milliards d'euros, c'était donc une bonne affaire pour l'État », se défend aujourd’hui Dominique de Villepin, accusé d’avoir bradé ce patrimoine national.
À l’époque, l’opération ne souleva guère d’objections dans les milieux politiques : la privatisation des autoroutes faisait consensus, à droite comme à gauche. Le processus avait été engagé depuis des années. Le gouvernement de Lionel Jospin l’avait mise à l’étude, en même temps que la privatisation d’EDF et de GDF. Laurent Fabius, alors ministre des finances, lança le début des opérations en 2002, en vendant 49 % du capital d’ASF à Vinci. Le groupe de BTP n’eut donc aucun mal à récupérer le restant en 2006. Nicolas Sarkozy, alors ministre des finances, poursuivit la privatisation rampante en ouvrant le capital d’APRR au profit d’Eiffage.
Il n’y eut que François Bayrou, alors président de l’UDF, pour s’opposer à la décision de Dominique de Villepin en 2006. Il dénonça alors l’erreur historique de ce choix, expliquant que l’État allait se priver à la fois d’une capacité d’intervention sur des infrastructures majeures dans le cadre des politiques d’aménagement du territoire, et de recettes substantielles pour les finances publiques. Joignant les actes à la parole, il déposa, avec l’association de défense des usagers des autoroutes privées, un recours devant le Conseil d’État pour contester la décision du gouvernement tant sur la forme que sur le fond. Dans son recours, François Bayrou soulignait notamment qu’une telle opération ne pouvait être réalisée par le biais d’un seul décret mais devait faire l’objet d’un débat et d’un vote parlementaire. Le Conseil d’État rejeta son référé : comme la vente d’ASF avait été effectuée dès la publication du décret, il n’y avait plus de recours possible.
Ainsi, en quelques semaines, trois groupes de BTP prirent le contrôle de 95 % du réseau autoroutier français à travers la privatisation de sept sociétés concessionnaires. Comme le rappelle un rapport de l’Autorité de la concurrence de septembre 2014, la privatisation des sociétés d’autoroutes intervient alors que la construction du réseau est quasiment achevée – le réseau autoroutier placée sous la responsabilité des sociétés privatisées a augmenté de 2 % depuis 2006 – et que les investissements passés sont en train d’être rentabilisés. À partir de 2000, les sociétés avaient commencé à afficher des bénéfices et à verser des dividendes à l’État. En 2005, ceux-ci s’élevaient à plus de 200 millions d’euros pour l’État. « La rentabilité était vouée à croître », insiste le rapport de l’Autorité de la concurrence.
Des contrats où les prix ne peuvent jamais baisser
Dans la précipitation de la privatisation, ni le gouvernement, ni l’administration des finances ou des transports, ne jugèrent bon de revoir en même temps les contrats de concession, les formules d’indexation des tarifs, les règles d’investissement. Négociés dans les années 1980 et 1990, ces contrats avaient été rédigés quand toutes les parties prenantes étaient publiques. Les sociétés privées ont adopté sans hésitation les engagements et les clauses de ces contrats : tout leur convenait parfaitement.
Gérant un quasi-monopole physique, les sociétés concessionnaires bénéficient aussi de contrats sur mesure. Chaque année, une clause prévoit que les tarifs doivent être revalorisés pour un montant représentant 70 % de l’inflation. Entre-temps, un nouveau dispositif a été ajouté : le contrat de plan. Négocié avec l’administration des transports sur une base pluriannuelle, ce contrat prévoit les travaux et les aménagements que les sociétés concessionnaires s’engagent à réaliser durant cette période. En contrepartie de ces efforts, l’État accepte de compenser tous les investissements réalisés.
Cela passe naturellement par le biais d’une nouvelle tarification, totalement à la charge des usagers. Ce nouveau mode de calcul prévoit une révision tarifaire annuelle, calculée sur la base de 0,85 % de l’inflation, à laquelle s’ajoute un coefficient multiplicateur, censé prendre en compte le coût du capital pour les investissements. Celui-ci oscille entre 6,7 % et 8,28 % selon les formules.
« Les contrats excluent toute idée de baisse tarifaire », note l’Autorité de la concurrence. Car rien ne vient contrebalancer, ou au moins tenter d’endiguer, cette formule inflationniste. Les investissements ne sont pas contrôlés. Ainsi, l’État accepte de compenser des investissements qui normalement relèvent de la charge normale du concessionnaire, comme l’a relevé la Cour des comptes.
De plus, nombre de travaux sont réalisés par des entreprises de travaux publics, filiales des grands groupes propriétaires des sociétés concessionnaires. Même si des appels d’offres sont lancés, ces dernières sont systématiquement favorisées. Les filiales de Vinci et d’Eiffage effectuent au moins un tiers des travaux sur les réseaux d’autoroutes contrôlés par leur maison-mère, alors que leur part tombe autour de 10 % ailleurs. Plus surprenant encore, relève l’Autorité de la concurrence : le critère de prix dans les appels d’offres pour les marchés de travaux est systématiquement minoré ou sous-pondéré, les commanditaires préférant mettre en avant les critères techniques pour justifier leur choix.
Dans l’autre sens, aucun mécanisme n’est prévu pour prendre en compte dans les tarifs les efforts de gestion ou les économies réalisées. Les sociétés concessionnaires ont pourtant diminué leurs charges de façon importante ces dernières années. Les coûts d’entretien ont baissé de 7 % depuis 2006. Les frais financiers, malgré un endettement croissant, ont été réduits de 10 % sur la même période, grâce à la baisse des taux et une gestion serrée des financements. Les effectifs ont baissé de 17 % pour tomber au total à 13 933 personnes. Mais ni les usagers ni l’État ne sont associés à ces gains.
« Ces contrats sont la contrepartie du risque », se défendent les sociétés autoroutières. Quel risque? rétorque l’Autorité de la concurrence. « Les charges auxquelles font face et pourraient faire face à l’avenir les SCA (sociétés concessionnaires autoroutières - ndlr) auraient pu être de nature à justifier la rentabilité exceptionnelle qui est la leur, à la mesure du risque que celles-ci constitueraient. Toutefois, l’analyse de ces charges, aujourd’hui maîtrisées, montre qu’elles ne représentent pas de risque, ni dans leur imprévisibilité, ni dans leur coût », pointe son rapport.
Il relève que les sociétés sont à l’abri de tout cycle économique, de tout ralentissement. Leur chiffre d’affaires (8,8 milliards d’euros en 2013) est en hausse constante, quelles que soient les circonstances : chaque baisse de trafic a pu être compensée grâce à la hausse des tarifs. L’Autorité de la concurrence en conclut : « Seule une crise plus grave que celle de la crise financière de 2008 pourrait éventuellement entraîner une baisse de leur chiffre d’affaires. »
La poule aux œufs d'or
Le détail a été oublié. Mais le scandale Zacharias a débuté en mai 2006, à cause de la privatisation des autoroutes. Antoine Zacharias, l’ancien PDG de Vinci, demandait alors à bénéficier d’une « récompense » supplémentaire de 8 millions d’euros, venant s’ajouter à son salaire annuel de 4 millions et à ses 250 millions de stock-options, « pour avoir bien su négocier la reprise d’ASF avec l’État ». Cette demande fut à l’origine d'un putsch à l’intérieur du groupe, de la division du conseil, et du scandale.
Mais sur le coup, cette exigence ne choqua pas une grande partie de ses administrateurs. Pour eux, il était normal d’accorder un généreux bonus à Antoine Zacharias pour le rachat d’ASF. Il avait obtenu dans des conditions exceptionnelles la poule aux œufs d’or pour le groupe. Vinci Autoroutes, qui exploite la moitié des autoroutes concédées en France, a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires (4,5 milliards d’euros) qui correspond à 11 % du chiffre total du groupe. Mais son bénéfice (798 millions) représentait 40,6 % des profits totaux de Vinci.
« La rentabilité exceptionnelle des SCA largement déconnectée de leurs coûts et disproportionnée par rapport au risque de leur activité, est assimilable à une rente », dit l’Autorité de la concurrence, confirmant d’autres rapports de la Cour des comptes qui a déjà souligné par deux fois la rente indue des sociétés autoroutières. Les chiffres que l’autorité de régulation donne, calculés à partir des comptes des sept sociétés concessionnaires, sont ahurissants. Ces dernières dégagent un excédent brut d’exploitation compris entre 65 % et 78 % du chiffre d’affaires, un résultat d’exploitation compris de 44 % à 51 %, un résultat net compris entre 20 % et 24 %. Même l’industrie de luxe ne parvient pas à dégager de telles marges.
Sentant la pression monter, les sociétés autoroutières contestent ces données. Elles ont commandé opportunément une étude auprès du cabinet Deloitte qui devrait être publiée dans la semaine. Selon le JDD, cet audit n’aboutit pas du tout au même résultat que ceux de la Cour des comptes et de l’Autorité de la concurrence. La rentabilité des autoroutes ne serait que de 8 % et non de 20 à 24 %, comme le dit l’Autorité de la concurrence.
« Il est temps d'arrêter les fantasmes et d'arrêter de faire dire n'importe quoi aux chiffres », dit Pierre Coppey, président de Vinci Autoroutes. « L'Autorité de la concurrence confond le résultat net comptable annuel avec le taux de retour sur investissement. » Insistant sur le fait que les concessionnaires ne sont assis sur « aucun magot », il rappelle leur endettement : plus de 30 milliards d’euros. « La concession permet d'investir massivement les sommes colossales qu'il faut pour construire un réseau [...] à la fin vous rendez l'actif, vous remboursez vos obligataires, vos actionnaires et il ne reste rien », assure-t-il. « Mais, si ce n’est pas intéressant, pourquoi s’accrochent-ils donc tant à ces contrats ? » s’interroge Laurent Hecquet, de l'association Automobilité et Avenir.
30 milliards d’euros d’endettement, c’est énorme. Mais tout cet argent n’a pas servi à construire le réseau autoroutier, comme les concessionnaires veulent le faire croire. Si celui-ci a été réalisé uniquement par l’emprunt depuis le milieu des années 1950, une partie avait déjà largement été remboursée au moment où les groupes de BTP ont mis la main dessus. À la date de la privatisation, leurs dettes totales s’élèvent à quelque 16 milliards d’euros, liées aux constructions réalisées auparavant. La moitié environ de ces emprunts a été contractée par la Caisse nationale des autoroutes. C’est-à-dire avec la garantie de l’État. Sans risque pour les exploitants.
Mais les acheteurs décident tout de suite d'alourdir la barque : ils financent l’acquisition des concessions autoroutières uniquement par emprunt ou presque. Leur modèle est celui de LBO (leverage buy out) géants, occasionnant des montagnes de dettes pour une pincée de capital, l’entreprise étant condamnée à dégager toutes les ressources financières pour se racheter, pour le seul et unique profit des actionnaires.
Les groupes ont à peine pris possession des concessions, qu’ils commencent à « en extérioriser toutes les richesses dormantes », dans les termes mêmes des milieux financiers. Alors que les sociétés concessionnaires, sous le contrôle de l’État, conservaient une partie de leurs profits pour renforcer leurs fonds propres et leur structure financière, les nouveaux propriétaires décident de faire exactement l’inverse. Elles ont totalement décapitalisé les sociétés concessionnaires.
À peine maîtres à bord, Vinci et Eiffage décident en 2007 d’un versement de dividendes exceptionnels de 3,3 milliards d’euros pour le premier auprès d’ASF, de 1,7 milliard pour le second auprès de APRR. Une partie de ces dividendes exceptionnels est prélevée sur les réserves de la société, une autre financée par l’endettement.
À l’issue de ces opérations exceptionnelles, les capitaux propres d’ASF, qui étaient de 3,8 milliards d’euros, retombent alors à 669 millions d’euros. Ceux d’APRR, qui s’élevaient à 1,7 milliard d’euros, deviennent négatifs à hauteur de 49 millions d’euros pendant deux années consécutives. « L’endettement d’APRR est alors 50 fois supérieur à ses fonds propres », note l’Autorité de la concurrence.
Même si le rythme s’est ralenti, la distribution s’est poursuivie par la suite. Alors que les sociétés concessionnaires versaient en moyenne 54 % de leurs bénéfices avant la privatisation, elles ont distribué entre 65 % et 153 % de leurs profits. Le taux moyen de distribution s’est élevé à 136 % des bénéfices. Au total, les sociétés ont perçu 14,9 milliards d’euros de dividendes entre 2006 et 2013, soit plus que le prix de leurs acquisitions, selon l’Autorité de la concurrence.
Pendant ce temps, leur endettement a augmenté de 17 % depuis 2006. Outre le paiement des dividendes, les sociétés ont choisi la voie de l’emprunt pour financer les travaux de rénovation et de développement qu’elles devaient payer. L’Autorité de la concurrence chiffre le montant total des travaux engagés à 4,5 milliards d’euros depuis 2006.
« Aucune autre société ne pourrait fonctionner avec de tels bilans », souligne Laurent Hecquet. « Quelle banque accepterait de prêter, quel investisseur accepterait de souscrire à des opérations obligataires auprès de sociétés qui n’ont quasiment pas de fonds propres, qui empruntent pour tout, y compris les opérations courantes ? S’ils le font, c’est qu’ils ont toutes les garanties nécessaires », constate-t-il. Les contrats en béton armé leur donnent effectivement une assurance tous risques.
Cette politique d’endettement hors normes a un autre mérite. Grâce à la déduction des frais financiers, elle permet de réduire le montant des impôts sur les sociétés. Les concessionnaires auraient ainsi économisé 3,4 milliards d’euros depuis 2006, par le biais de ce mécanisme. En 2013, le Parlement a bien prévu de réduire cette niche fiscale, en limitant le montant des déductions des frais financiers. Mais les concessions ont été exclues de la mesure.
À l’automne, l’Assemblée nationale a repris l’ouvrage sur le sujet, en incluant les sociétés concessionnaires d’autoroutes dans les limitations de la niche fiscale. Ces dernières menacent de saisir les tribunaux pour distorsion de concurrence, si la mesure n’est pas revue.
La capture de l’État
Chaque année, la sous-direction chargée du réseau autoroutier, au ministère des transports, négocie presque seule, sans y associer au moins le ministère de l’économie et des finances, les hausses des tarifs à venir avec les sociétés concessionnaires. Une situation invraisemblable, selon le dernier rapport de la Cour des comptes sur les autoroutes. « Les sociétés concessionnaires appartiennent à des groupes importants, Vinci et Eiffage notamment. Pour ces groupes, les tractations tarifaires s’inscrivent dans un ensemble plus large d’interaction avec l’État sur d’autres projets à forts enjeux, notamment ferroviaires ou de construction et de concessions de bâtiments dans le cadre de partenariat public-privé », rappelle-t-il.
Mais ce n’est qu’une des manifestations de la capture de l’État organisée par les groupes de BTP. Ils sont chez eux au ministère de l’équipement, des transports ou même des finances. Ils connaissent le personnel administratif, savent à qui il faut s’adresser pour défendre un projet, obtenir un aménagement, soutenir un texte réglementaire. Les responsables administratifs font preuve à leur égard de la plus grande compréhension pour la défense de leurs intérêts.
La Cour des comptes a relevé des exemples hallucinants de cet entre-soi, qui se passe toujours au détriment de l’État. Ainsi, lors d’une renégociation d’un contrat de plan, APRR défendait un taux de rentabilité de 7,5 %. La direction des transports jugeait ce taux inacceptable et proposait un taux de 6,7 %. Une simple note transmise au cabinet du ministre signée de la main du directeur général du transport, avec mention manuscrite « après contact avec le PDG d’APRR », suffit pour trouver l’accord : il y proposait un taux de rentabilité de 8,08 %, soit plus que ce que proposait la société concessionnaire au départ. Ce fut naturellement ce taux qui fut arrêté !
Des exemples comme cela, il y en a des dizaines. Il fallut par exemple que la Cour des comptes dénonce, dans un premier rapport publié en 2008, le système de tarification mis en place par les sociétés concessionnaires, qui consistait à faire payer beaucoup plus les parties du réseau autoroutier les plus fréquentées, pour que le ministère des transports reconnaisse que la situation n’était pas optimale. Auparavant, il n’avait rien vu.
Il n’a rien vu aussi quand les sociétés concessionnaires n’ont pas respecté leurs obligations d’investissements. Il n’a rien vu non plus quand ces dernières ont présenté la facture de charges qui relevaient de leurs obligations normales de concessionnaires. Il est vrai que celles-ci, disposant de toutes les données, transmettent ce qu’elles veulent aux autorités censées les contrôler.
De même, la commission nationale des marchés n’a rien vu quand les sociétés d’autoroutes ne respectaient pas les engagements pris dans le cadre de leur contrat, ne pratiquaient pas d’appels d’offres, prenaient des avenants qui les dispensaient de toute mise en concurrence. Depuis la privatisation de 2006, pratiquement aucune sanction n’a été prise contre les sociétés concessionnaires.
La capture de l’État va grandissant. Les allers et retours entre privé et public sont tellement devenus la norme que les problèmes d’endogamie ne semblent même plus poser question. À son arrivée à Matignon, Manuel Valls a nommé Loïc Rocard, fils de Michel Rocard, comme conseiller transports. Il l’a pour cela débauché du privé : il était alors directeur général de Cofiroute, une des concessions autoroutières de Vinci. Les services du premier ministre assurent qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts. « Il a annoncé dès son arrivée qu’il se mettait à l’écart pour tous les dossiers concernant les autoroutes. C’est un autre conseiller qui traite le dossier », assure-t-on.
Cela ne suffit pas à rassurer les nombreux députés, associations ou autres, qui souhaitent une remise à plat du dossier autoroutier. Tous redoutent que les intérêts privés des groupes de BTP soient désormais portés si haut au sein de l’appareil d’État que rien ne puisse bouger, et que le système se perpétue, pour le seul bénéfice de la rente.
A lire aussi sur le blog de Tuxicoman : Mini guide MySQL