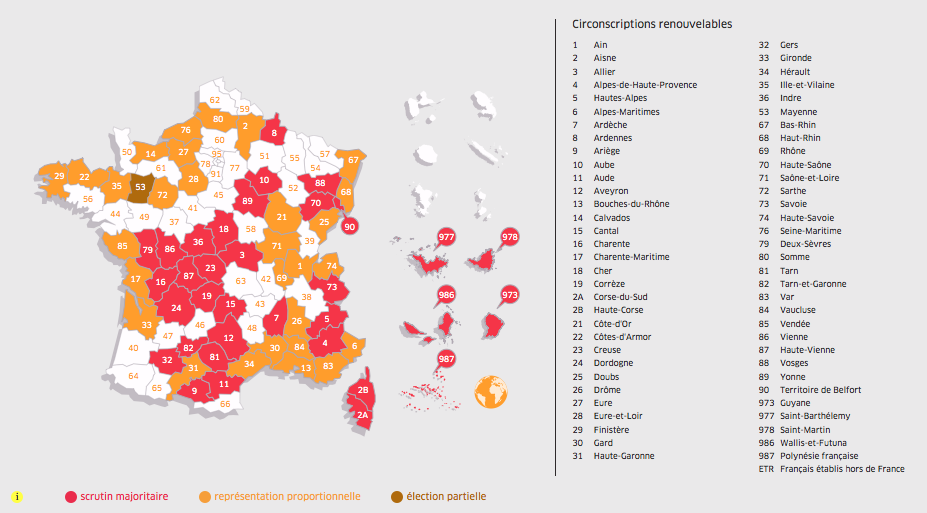Ils sont venus, ils se sont vus, et s’ils ne s’avouent pas encore vaincus, ils sont loin de se mettre d’accord pour la suite. Ce week-end à la fête de l’Huma, au parc de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), le beau temps a souvent été vu comme un signe optimiste pour les lendemains de la gauche. À travers des allées fournies d’une foule plus nombreuse que les deux années précédentes, la gauche critique, en délicatesse avec le gouvernement Valls, veut croire, avec plus ou moins d’enthousiasme et de sincérité, au début d’un quelque chose alternatif. « Le soleil brille sur la gauche, ça nous change de la pluie hollandaise », rigole un militant derrière son stand de saucisses-frites.
Puissance invitante d’un rendez-vous qu’ils ont voulu comme celui de « la gauche qui se reparle », les communistes jouent un chemin alternatif et unitaire qu’ils entendent tracer avec la meilleure bonne volonté possible. « Paradoxalement, le scénario d’un FN au second tour, qu’agitent tant Manuel Valls et Jean-Christophe Cambadélis, nous enlève des scrupules et doit nous décomplexer, explique la dirigeante communiste Marie-Pierre Vieu. Car on est sûr en l’état actuel que le PS ne sera pas en face. Donc il faut trouver autre chose. »
Lors d’un déjeuner avec la presse vendredi, le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, a résumé le message qu’il n'a pas cessé de marteler au gré de ses interventions de tribunes et de médias : « Désormais, on doit construire l’alternative sociale que les Français voulaient en 2012. »
Pierre Laurent espère que le rassemblement du Front de gauche avec les écologistes et les “frondeurs” du PS va se concrétiser dans « la riposte » à l’Assemblée, voire dans la rue, puis dans « la recherche de solutions communes » et enfin dans la perspective d’une coalition électorale, pudiquement nommé pour l'instant « travail de rassemblement ». « Nous prendrons toutes les initiatives nécessaires pour faire dialoguer toutes les forces de gauche qui ne se reconnaissent pas dans le gouvernement », dit-il.
Pour l’instant, l’heure est à la reprise de contact, entre embrassades de travées et banquets devant caméras. Chacun s’arrange de cette ritualisation de l’unité de la gauche, qui semble condamnée à rester éternellement un combat. « On ne va passer à l’alternative en deux jours, admet Pierre Laurent. Les intérêts partisans de chacun ralentissent les convergences. Nous, on envoie le signal qu’on est disponible et qu’il faut aller vite. »
L’un de ses proches confie, en "off" : « Se retrouver autour d'une table, ça n’allait déjà pas de soi pour certains. C’est aussi pour cela qu’on a fait un repas plutôt que de s’essayer à un communiqué commun. On en est là… »
Samedi midi, sous la tente du stand de la Côte-d’Or et les pieds dans l’herbe, le repas de la gauche alternative avait des airs de Cène incertaine. « On ne sait pas encore qui sera Judas », rigole un convive. Autour des escargots et d’une dizaine de dirigeants communistes et du Front de gauche (Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel, Clémentine Autain ou Christian Picquet), on retrouve les socialistes de l’aile gauche (Jérôme Guedj, Pascal Cherki, Barbara Romagnan ou Marie-Noëlle Lienemann), ou des proches de Martine Aubry (Christian Paul ou Jean-Marc Germain). Mais aussi Isabelle Attard, co-présidente de Nouvelle donne, le président de la Ligue des droits de l’homme, Jacques Dubois, l’ancienne présidente du syndicat de la magistrature, Évelyne Sire-Marin, l'ancienne co-présidente d’Attac, Aurélie Trouvé.
Enfin les écologistes Jean-Vincent Placé et David Cormand, qui expliquent tous deux que le groupe EELV à l’Assemblée devrait en grande majorité s’abstenir lors du vote de confiance, mardi 16 septembre. Tout le week-end, le PCF aura aussi multiplié les assauts d’amabilités envers les écolos. Envers Cécile Duflot, venue vendredi débattre sur le logement et défendre sa loi Alur, « qui n’est pas la loi Duflot, mais une des rares lois votées par toute la gauche ». Ou envers Emmanuelle Cosse, qui s’est fait applaudir par l’assistance en parlant transition énergétique et santé au travail.
Le banquet n’a pas franchement débouché sur une quelconque initiative, ni même de grandes discussions politiques. Juste une bouffe, pour s’assurer que ça vaut bien le coup de se revoir pour parler sérieusement. « On est dans les préliminaires, mais il va vite falloir passer aux travaux pratiques, explique le dirigeant écologiste David Cormand. Déjà, on va y voir plus clair après le vote de confiance, et savoir sur combien de parlementaires on pourra s’appuyer. »
Là encore, les communistes n’ont cessé d’exprimer un soutien compréhensif aux “frondeurs”, ces députés socialistes qui refusent la caporalisation libérale engagée par Manuel Valls. « Je sais bien que ça va se finir par des abstentions et que ce ne sera pas suffisant pour obtenir un changement de gouvernement, explique Pierre Laurent. Mais il n’y a pas si longtemps, il n’y avait pas de frondeurs. » Ceux-ci assument de ne pas vouloir faire tomber le gouvernement Valls, mais confirment leur amertume. « À cette étape, on assume. À cette étape… », dit Pascal Cherki. Marie-Noëlle Lienemann abonde : « Le vote contre serait une occasion pour la direction du PS de nous exclure du PS, car “ils” rêvent de garder le parti. » La sénatrice, figure de l’aile gauche socialiste, estime à 63 le nombre d’abstentions nécessaire pour faire tomber Valls, sans y croire toutefois. Car ils ne devraient être qu’autour d’une trentaine de députés PS à “fronder”, pronostiquent certains.
Chez les aubrystes, on vit la séquence comme un avertissement supplémentaire, renforcés par les nouvelles déclarations de la maire de Lille, « carte postale » supplémentaire à l’attention du pouvoir. « J'ai été premier secrétaire du PS, a ainsi rappelé Martine Aubry samedi, depuis une assemblée de la fédération du Nord, à laquelle était présent le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis. On fait l'unité en parlant du fond, on ne fait pas l'unité en disant "Unité, unité, unité". On fait l'unité sur un projet, on fait l'unité sur des valeurs, sur un sens et sur des réponses. » Avant de se prononcer « pour l'indépendance de chacun », au moment de voter ou non la confiance au gouvernement Valls 2. Pourtant, tout le monde reste encore dubitatif (au minimum), quant à un retour de celle qui incarne à merveille le rassemblement unitaire de cette gauche critique du gouvernement, mais qui incarne aussi toutes ses incertitudes.
Alors, faute d’imam sortant de sa cachette, ses proches demandent a minima que « les réunions de groupe PS ne soit plus un lieu où à chaque vote, c’est “soumission ou apocalypse” », selon les termes de Jean-Marc Germain. Ou ils exigent « la fin de cette période où la gauche ne pourrait pas se parler », comme Christian Paul. Ce dernier défend aussi « la nécessité d’un plan d’urgence sociale » qu’il souhaiterait voir mis en œuvre à l’Assemblée par la majorité parlementaire, autour de dispositifs fiscaux favorisant le pouvoir d’achat, d’une réelle conditionnalité de l’octroi du CICE (Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) aux entreprises, notamment en matière de création d’emplois, ou d’une nouvelle loi bancaire.
Mais aucun de ces frondeurs socialistes ne sait vraiment au bout de combien d’avertissements ils pourraient passer au blâme du gouvernement Valls. Et c’est ce qui irrite, ou du moins ne convainc pas, les sceptiques du Front de gauche. Au PG, on continue ainsi à afficher son désaccord stratégique. Et on martèle la nécessité de « ne plus s’allier au système libéral », c’est-à-dire au PS, comme l’a scandé Éric Coquerel à la tribune du débat unitaire de la fête de l’Huma.
Si on se plie de bonne grâce aux mises en scène confortant la subsistance du Front de gauche, assurant son attachement au rassemblement né il y a désormais six ans, le cœur ne semble plus y être vraiment, comme à Montreuil la semaine passée (lire ici). « Les frondeurs ne sont pas des révolutionnaires, franchement, maugrée Jean-Luc Mélenchon. Disons qu’ils sont mignons, là où les autres sont moches. » Ce dernier a choisi de repartir au combat, façon de démentir ces médias qui se seraient « réjouis trop vite » de ce qu’ils avaient interprété hâtivement comme une retraite.
Sans conteste, le héraut de l’autre gauche semble avoir digéré sa lassitude estivale et ce qu’il admet lui-même comme un échec stratégique, celui de ne pas être parvenu à dépasser le PS aux dernières européennes. Revigoré par un accueil chaleureux dans les allées de la fête (là où celui des deux dernières années était plus frais, voire tendu), enchaînant selfies bravaches et embrassades militantes, Jean-Luc Mélenchon veut regarder d’un air distant les discussions entre partis de gauche, car à son sens ce n’est plus là que ça se joue.
Au stand du Parti de gauche, il a prononcé un discours devant une foule nombreuse, débordant très largement dans les allées de la fête, et a assuré les « siens » qu’il ne « déserterai(t) jamais (son) poste de combat ». « On est dans un moment de reconstruction, confie-t-il ensuite à quelques journalistes. En ce moment, ça se cristallise sur la souveraineté populaire. »
Après le parti allemand Die Linke (« son échec nous a indiqué que créer un parti n’était pas la solution, c’est pour ça que nous avons continué de privilégier le Front »), les révolutions arabes (il a laissé la parole au candidat du Front populaire tunisien Hamma Hammami), la coalition grecque Syriza (dont il estime que « le besoin d’experts les a conduits à recycler des sociaux-démocrates en rupture »), Mélenchon louche désormais du côté de l’Espagne. Et du mouvement Podemos, parti en construction, issu du mouvement des Indignés. « Il y a plein de bolivariens dedans », glisse-t-il en allusion à une autre de ses références stratégiques internationales, celle des révolutions citoyennes sud-américaines (lire ici).
La souplesse et l’innovation de Podemos, qui a recueilli 8 % aux dernières européennes et envoyé cinq eurodéputés à Strasbourg et Bruxelles, sans même avoir créé encore de parti, cela rend admiratif Mélenchon. « Ils disent ce que je n’ai jamais osé dire », confie-t-il. Lui ne cache pas leur emprunter leur définition d’un nouveau clivage, surpassant gauche et droite, entre front du peuple et oligarchie. « Ils donnent la ligne d’une nouvelle confrontation », explique l’ancien candidat à la présidentielle, qu’il résume en une formule centrale, reprise aux Espagnols : « Le système n’a plus peur de la gauche, il a peur du peuple. »
Cette nouvelle approche ne convient pas franchement aux communistes, ainsi que l’explique Pierre Laurent : « Je vois l’idée que la gauche ne se relèvera pas de Hollande et Valls et qu'il faudrait donc faire autrement. Mais je n’y crois pas, car des millions de gens se retrouvent dans cet imaginaire, et cela reste un levier politique fort. Même s’il est vrai qu’ils ne mobilisent pas toutes les classes populaires, les partis restent un creuset de la démocratie, qu’on ne peut pas bazarder comme ça d’un coup. » En revanche, l’universitaire et “socialiste affligé” Philippe Marlière, qui a critiqué ce nouveau clivage dans un récent ouvrage collectif (lire ici), avoue son trouble sur la question, après en avoir longuement discuté avec deux des responsables de Podemos, venus à la fête de l’Huma. « Il faut que je cogite », sourit-il.
Samedi matin, ces deux-là, Pablo Bustinduy et Jorge Lago, ont détaillé minutieusement, et dans un français impeccable, leur « renouvellement profond du récit, des méthodes et des pratiques » politiques, lors d’un débat sur le stand du PG. « Si l’on veut repolitiser la souffrance et la colère, il faut admettre que le clivage gauche/droite est rejeté et faire un pari audacieux, y a expliqué Bustinduy. Nous ne savons pas qui nous sommes exactement, ni quelle est l’exactitude de nos convergences sur ce que nous voulons, mais nous savons qui ils sont en face, et nous opérons une construction politique par rapport à ceux dont nous ne voulons plus. » Podemos serait alors « un parti fondé sur une hégémonie et non une idéologie, ajoute Lago, où l’on part du plus petit dénominateur commun pour rassembler au maximum, puis on élargit toujours un peu plus ».
Concrètement, ces indignés-là ont choisi d’abord de « briser un tabou à gauche » en créant en premier lieu « une structure purement électorale ». Ouvertes à qui le souhaitait, des primaires de désignation ont vu 150 candidats se présenter aux suffrages. Plus de 30 000 votants et plus d'une centaine de milliers d’adhérents plus tard, voici Podemos quatrième force du pays, devant le partenaire traditionnel de la gauche radicale européenne, Izquierda unida.
Cet éloge de l’action dépassant les questions de chapelles plaît à Mélenchon, qui se désespère régulièrement des manques d’audace ou temporisations de ses alliés communistes. « Tout est figé, alors on laisse ceux qui veulent se retrouver autour d’une table pendant six mois, un an, deux ans… Nous, on agit et on voit, dit Alexis Corbière, dirigeant du PG. Si ça ne marche pas, tant pis, au moins on aura essayé. »
Son Podemos à lui, ce sera le « m6r », pour Mouvement pour une VIe République. Une page internet vient d'être créée, recueillant 16 000 signatures en deux jours, assure-t-il, sans compter celles obtenues dans les allées de la fête. Là encore, il s’inspire de l’expérience espagnole, et promet « un réseau social totalement horizontal, sans chefs ni cartes d’adhérents », capable de s’autogérer pour préparer les esprits à la révolution citoyenne, et appliquant « la démocratie la plus directe possible ». Pour bien montrer qu'il entend faire différemment, le logo n'a plus rien à voir avec le graphisme mélenchonien. Ni rouge, ni vert, le logo du « m6r » est jaune et orange, et aussi un peu bleu, ressemblant à un dessin enfantin de soleil ou d'étoile.
Lors de son discours, il a cherché à donner corps à l’enjeu d’une constituante, face à ceux qui jugent « trop abstraite » son idée. S’inscrivant dans l’histoire des républiques précédentes, « qui ont toujours servi à sortir du monarchisme, de l’empire ou du pétainisme », il voit sa VIe République comme l’outil « pour sortir du néolibéralisme qui détruit la démocratie pour pouvoir fonctionner ».
À ses yeux, il s’agit de « combiner stabilité des institutions et capacité d’intervention populaire ». Il évoque le « référendum révocatoire » afin de sanctionner des élus en cours de mandat, mais voit surtout la VIe République comme « un mot d’ordre social », constitutionnalisant « la démocratie dans les entreprises », « droit de préemption coopératif et ouvrier » en cas d’abandon d’un site par un propriétaire, élection « vraiment représentative pour le patronat », inscription de droits fondamentaux tels que « le partage, la citoyenneté, l’humanité universelle » ou « règle verte », sorte de règle d'or écologique.
Et puis, Mélenchon ne peut s’empêcher de glisser malicieusement en marge de la tribune, combien un recentrage de son action politique sur la constituante permettrait de lever un désaccord inconscient avec les communistes. « On a un cadavre dans le placard sur le sujet, dit-il en souriant. En 1917, la constituante a été dispersée par les bolcheviks… » Façon de convoquer l’histoire pour enfoncer un coin dans l’attitude dubitative des communistes français, pourtant bien lointains héritiers de la révolution d’Octobre…
Peut-être pour la première fois de sa longue carrière politique, Mélenchon ne sait-il pas où il va, n’a pas planifié son affaire plus que ça, et semble se réjouir de sauter dans l’inconnu, loin des tergiversations d’appareils. « Je ne sais pas comment ça marche, mais les camarades de Podemos vont nous l’expliquer et nous donner leurs outils. Je ne sais pas si on va y arriver, mais venez les gens, prenez le boulot en main, parce que moi, je sature ! » a-t-il lancé au micro.
Quand on lui demande quelles initiatives vont être prises, il parle d’agiter les réseaux sociaux, « avant de voir comment on peut passer du virtuel à la rue ». S’il évoque en passant la possibilité d’une nouvelle marche en novembre, pour le mi-mandat de François Hollande, pour qui les mots sont toujours aussi durs (« mais c’est devenu presque doux par rapport à ce que disent désormais les socialistes eux-mêmes »), il paraît persuadé que tout peut passer par Internet. Il dit ainsi regarder vers Avaaz, un site de pétitions et de mobilisations qui l’intrigue aussi fortement, et rappelle son intérêt ancien pour « l’école de formation de masse » qu’est devenu le numérique. « Quand j’étais jeune, on était fier d’avoir tiré un tract à 2 000 exemplaires, dit-il. Aujourd’hui, entre mon blog, twitter et Facebook, on s’adresse à des centaines de milliers de personnes. »
Quand on souligne que certains fondamentaux de Podemos ne semblent toutefois pas aisément transférables dans la gauche, comme la méthode de primaires archi-ouvertes pour les investitures (un exercice auquel le Front de gauche dans son entier a toujours été hostile), ou encore le profond renouvellement du personnel politique (majoritairement trentenaire et non-professionnel de la politique), il acquiesce, tout en faisant remarquer que « former de nouveaux militants prend du temps ». Mais ce samedi à la fête de l'Huma, il ne semble pas vouloir déjà penser à tout cela : « Il va falloir s’habituer à ce nouvel angle, comme il va falloir s’accorder avec les communistes. Mais de toute façon, soit on continue comme avant et on se fera dégager, soit on y arrive. » En aura-t-il assez et cela sera-t-il suffisant pour ouvrir un nouveau « cycle ascendant », comme il dit ? Lui-même ne le sait pas, mais il semble au moins y prendre du plaisir.
A lire aussi sur le blog de Tuxicoman : Profession journaliste inutile