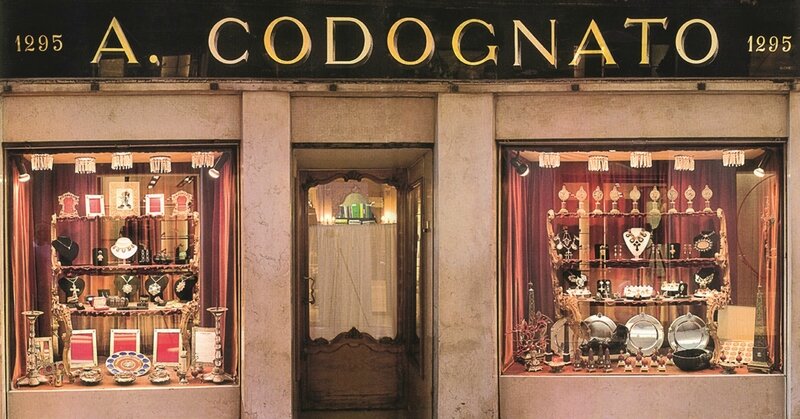Et maintenant la purge ! Voilà que nos hérauts du social-libéralisme (mais est-il encore social ?), qui tiennent le gouvernement depuis la nomination de Manuel Valls à Matignon, font leur le vieux principe léniniste : le parti se renforce en s’épurant. Haro donc sur les voix dissonantes. Le limogeage du gouvernement, au mois d’août, d’Arnaud Montebourg, d’Aurélie Filippetti et de Benoît Hamon n’était qu’un hors-d’œuvre. Il faudrait maintenant engager des procédures d’exclusion du parti socialiste pour les grandes gueules (visé, Gérard Filoche) comme pour les voix dissidentes et critiques de ces anciens ministres qui refusent de se taire (lire ici l’article de Mathieu Magnaudeix).
L’histoire n’est pas qu’anecdotique – une énième crise de nerfs dans un PS à vau-l’eau – tant elle illustre l’ampleur d’une crise sans précédent. C’est une crise provoquée par la fusion d’un socialisme de gouvernement vidé de tout sens et d’institutions de la Ve République à bout de souffle. Le résultat est cet autoritarisme des faibles, coups de menton de Manuel Valls, menaces de Jean-Christophe Cambadélis et de Jean-Marie Le Guen, emportements de Stéphane Le Foll. Quand le caporalisme prétend ainsi effacer la politique – et les institutions l’autorisent –, la catastrophe n’est jamais loin pour la gauche. Les derniers scrutins, municipaux et européen, nous en ont donné un avant-goût (lire notre précédent article «Il est minuit moins cinq»).
Car comment s’offusquer qu’Aurélie Filippetti, Benoît Hamon, mais aussi Delphine Batho et Cécile Duflot, anciens ministres redevenus députés, ainsi que les proches d’Arnaud Montebourg se soient abstenus sur la première partie du budget 2015 ? C’est bien le contraire qui aurait posé un « problème éthique », selon la formule de Jean-Christophe Cambadélis, un spécialiste de la chose… Depuis des mois, ces responsables, d’abord au sein du gouvernement puis publiquement pour en expliquer leur départ, n’ont cessé de multiplier les alertes avant de dire leurs désaccords face à une politique qui tourne le dos à l’électorat de gauche et accumule les échecs (500 000 chômeurs de plus depuis mai 2012).
Que leur vote soit en cohérence avec leurs engagements ne peut étonner que le trio Cambadélis-Le Guen-Valls. Car l’abstention d’une quarantaine de députés lors du vote de cette première partie du budget n’est que la traduction du débat nécessaire que doivent mener le PS et, au-delà, l’ensemble de la gauche. Débat que le trio sus-cité veut à tout prix étouffer pour plusieurs raisons.
Mois après mois, députés frondeurs et autres responsables socialistes critiques ont réussi, aidés par les écologistes et le Front de gauche, à installer au centre du débat public une question autrement plus large que le simple problème de la solidarité du parti majoritaire et de ses alliés avec l’exécutif. L’enjeu est tout autre : il s’agit dans l’urgence des catastrophes électorales, des échecs économiques et sociaux, et de la montée de l’extrême droite, de redéfinir ce que la gauche peut et doit faire de l’exercice du pouvoir.
C’est l’enjeu brutalement posé ce mercredi par Benoît Hamon, affirmant que la politique de l’exécutif « menace la République ». Et ajoutant que « la menace de la République, c’est la préparation pour 2017 d’un immense désastre démocratique », soit « non seulement l’arrivée au second tour de la présidentielle de Marine Le Pen sans coup férir, mais en plus la menace que demain, elle dirige le pays ».
Ce constat aurait plus de force encore si l’ex-ministre de l’éducation s’était expliqué clairement sur les raisons de son alliance de circonstance avec Manuel Valls et Arnaud Montebourg au lendemain des municipales pour imposer un nouveau gouvernement à François Hollande… Mais la rupture est bel et bien consommée et Manuel Valls n'entend pas engager ce débat. Pour une raison immédiate : il serait lourdement minoritaire au sein même de son parti, sans parler des autres composantes de la gauche. Même les radicaux de gauche jouent à faire claquer les portes, c'est dire…
Car la légitimité de Manuel Valls n'est aujourd'hui qu'institutionnelle, dépendant du seul choix présidentiel de l'avoir nommé à Matignon. Sans majorité politique au sein du parti majoritaire, son seul levier de pouvoir est sa fonction de premier ministre. C'est de ce levier qu'il a usé pour placer Jean-Christophe Cambadélis à la tête du PS, sans consultation militante, et Jean-Marie Le Guen en charge des relations avec le Parlement, donc de la conduite de la majorité parlementaire.
Qu'une consultation non contrainte intervienne – comme ce fut le cas par exemple lors des primaires de 2011 – et il ne fait guère de doute que ce trio serait balayé. D'où l'argument d'autorité, appuyé par le carcan institutionnel, utilisé pour faire rentrer dans le rang toute voix ou entreprise dissonante. Car dans le même temps, toujours abrité en son fortin de Matignon, le premier ministre prétend faire avancer son projet politique de fond : la liquidation de l'héritage idéologique du parti d'Épinay pour un social-libéralisme dit moderne et décomplexé.
À sa manière, Emmanuel Macron l'avait dit à Mediapart, avant même sa nomination au ministère de l'économie : « L’idéologie de gauche classique ne permet pas de penser le réel tel qu’il est » ; le temps est venu de se débarrasser de cette « étoile morte » (lire ici l'article de Lenaïg Bredoux). Jean-Marie Le Guen, chargé lundi de faire feu sur Martine Aubry et sa critique virulente de la politique de l'exécutif, a énoncé le même programme dans Le Monde : « L'incapacité de la gauche à porter un projet de société moderne pousse les Français à se tourner vers la droite et, pire, vers le FN. Soyons honnêtes, le vieux logiciel socialiste n'attire plus. »

Manuel Valls enfonce le clou dans l'Obs, à paraître ce 23 octobre : « Il faut en finir avec la gauche passéiste, hantée par le surmoi marxiste et par le souvenir des Trente Glorieuses », assène le premier ministre en couverture de l'hebdomadaire, décrétant l'heure venue d'un nouveau parti pour lequel les militants n'ont été ni consultés ni invités à débattre ! Il s'agit désormais de « bâtir une maison commune de toutes les forces progressistes » et de s'ouvrir au centre. Il s'agit de ne plus dire gauche socialiste mais « gauche pragmatique, réformiste et républicaine ». Au fait, qu'en dirait donc cet électorat socialiste qui, il y a trois ans, accordait moins de 6 % de ses suffrages (sur environ trois millions de votants) au candidat à la primaire Manuel Valls ?
La volonté de passage en force du premier ministre n'est pas que le symptôme de sa fragilité politique. Elle vient souligner l'épuisement du modèle classique de la Ve République, exécutif irresponsable et parlement croupion. François Hollande aura ainsi engagé cette phase ultime de la crise de la gauche dans les habits de Ve. Dans son nouveau livre, Les Derniers Jours de la Cinquième République, comme il l'avait fait dans ses articles dans Mediapart (ils sont à lire ici), Christian Salmon diagnostique l'étendue de cet affaissement démocratique, pouvoir impuissant, débats anémiés, citoyens dépossédés.
Journal pluraliste, ambitionnant d'être le lieu de toutes les rencontres visant à reconstruire une espérance pour la gauche, Mediapart a dès le lendemain des élections municipales organisé des débats entre les différentes forces de gauche (ici notre live). De son côté, après les nombreuses conversations avec des ministres et responsables de gauche qui nourrissent son livre, Christian Salmon a demandé à plusieurs d'entre eux d'exercer leur « droit de suite ». « Droit de suite », donc de débat. Celui que refusent aujourd'hui l'exécutif et le PS. Celui que nous vous proposons ci-dessous avec ces trois textes rassemblés par Christian Salmon, textes d'Aurélie Filippetti, de Cécile Duflot et de Jean-Luc Mélenchon.
A lire aussi sur le blog de Tuxicoman : Je casse, tu paies