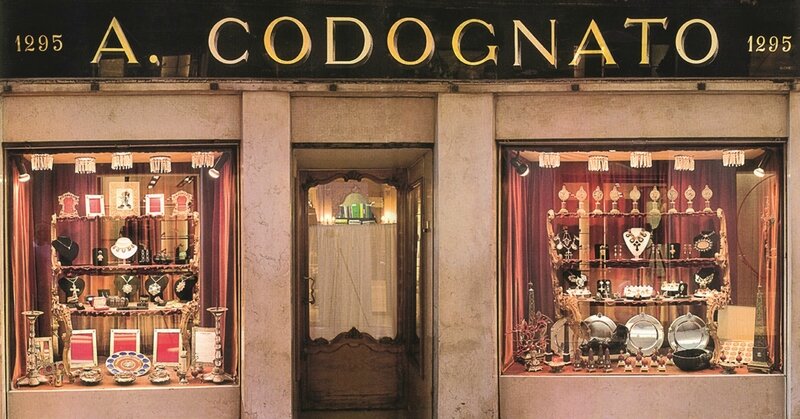Au contraire de sa collègue ministre écologiste Cécile Duflot, lui a choisi de ne pas raconter dans le détail son expérience et la déception de sa participation à un gouvernement élu par la gauche. Quatre mois après avoir refusé de rentrer dans le gouvernement Valls, Pascal Canfin a choisi de reprendre contact avec la vie réelle. Pour lui comme pour son livre (Imaginons..., éditions Les Petits Matins). L'ancien eurodéputé EELV n'a plus de mandat désormais (il est devenu « conseiller climat » en vue de la conférence Cop 21 prévue à Paris en décembre 2015, pour le think-tank World resource institute), et a désiré faire son état des lieux politique par le biais de dialogues avec des « vraies gens » (une ouvrière, un patron de PME, une infirmière, un financier, une responsable à Pôle emploi, un militant associatif de quartier).
Vous publiez un livre d’entretiens avec six citoyens français, mais n’évoquez que brièvement votre expérience ministérielle. Pourquoi ne pas avoir fait de retour d’expérience, comme votre collègue écologiste Cécile Duflot ?
Précisément, les deux livres sont complémentaires. L’un raconte ce qui a conduit à la désillusion et à notre départ conjoint du gouvernement en avril, l’autre est davantage tourné vers des propositions pour incarner une alternative, et montrer qu’on n’est pas condamné au “Tina” (There is no alternative). Quand Manuel Valls dit qu’il n’y a pas d’autre politique possible, c’est la négation même de la politique, qui est d’avoir à choisir entre plusieurs chemins. Nous sommes partis du gouvernement en avril car nous avions anticipé ce qui allait se passer. Nous sommes donc aujourd’hui bien placés pour incarner une autre politique à gauche. C’est pourquoi je montre dans le livre qu’il y a bien une alternative, même en intégrant la réalité européenne actuelle, pour proposer une autre politique. C’est le cœur de cet ouvrage qui est le premier livre politique écrit sous la forme de dialogues avec des Français, y compris par exemple une ouvrière à la chaîne qui a voté Le Pen en 2012.
Par rapport au récit de Cécile Duflot, avez-vous vécu pareille désillusion ? Auriez-vous raconté la même histoire et la même déception ?
Je partage l’idée qu’il était – et qu’il est bien sûr – toujours possible de faire autrement. Je suis aujourd’hui le seul responsable politique écologiste à avoir une expérience européenne, au Parlement européen, et au gouvernement. J’ai donc vu de l’intérieur à Paris comme à Bruxelles comment cela fonctionne – ou dysfonctionne notamment en raison d’une bien trop grande perméabilité au lobbying exercé par quelques puissants intérêts privés. Je raconte dans le livre par exemple comment la France a (jusqu’à présent) cédé au lobbying d’Alstom pour ne pas supprimer les subventions publiques à l’exportation de charbon alors que Obama a pris cette initiative en résistant à General Electric. Pareil pour la taxe sur les transactions financières, où j’ai vu la bataille des banques et l’absence quasi totale d’engagement politique en face. Et cela est vrai pour tous les sujets financiers, comme la loi bancaire l’a largement illustré.
Il y a d’un côté un grand discours politique disant qu’il faut réguler la finance puis les discussions passent tout de suite à un niveau technique, où le lobbying des banques détricote l’ambition initiale. C’est pour cela que j’explique dans le livre combien il serait essentiel de nommer, en France comme ailleurs, un ministre spécifiquement en charge de la régulation financière et de la lutte contre les paradis fiscaux. Il est quand même étonnant d’avoir un ministre des anciens combattants mais pas de ministre sur les paradis fiscaux ou sur la fiscalité internationale ! Il faut adapter la composition du gouvernement aux enjeux du siècle. Aujourd’hui, il y a un déficit démocratique extraordinaire sur ces questions pourtant majeures si l’on veut montrer que le politique peut reprendre la main sur la globalisation financière : alors même qu’on demande des efforts financiers aux Français, on ne demande pas grand-chose aux responsables de la crise financière. Cet écart nourrit tous les populismes.
Est-ce qu’aujourd’hui, d’après vous, il y a une perspective optimiste pour la gauche qui n’est plus au gouvernement ?
D’abord, je constate que les faits économiques et politiques nous donnent raison. À force de s’être éloigné des promesses de 2012, la base politique du gouvernement de Manuel Valls est extrêmement étroite et ne représente désormais qu’une seule partie du PS, dont on ne sait même pas si elle est vraiment majoritaire. Sur le plan économique, l’effet cumulé des 40 milliards attribués aux entreprises sans contreparties et sans vision stratégique et de la baisse de 50 milliards des dépenses publiques a un effet récessif, qui empêche de créer des emplois, d’investir dans l’avenir et notamment dans la transition écologique, mais empêche aussi… de réduire les déficits. Même d’un point de vue de bonne gestion financière, et cela m’importe, cette trajectoire échoue à atteindre ses objectifs. C’est pourquoi l’idée selon laquelle il y aurait d’un côté les responsables et de l'autre les « irresponsables » comme le prétend le premier ministre me heurte profondément. Ce qui est irresponsable aujourd’hui est de donner via le CICE et le Pacte de responsabilité 1 milliard aux banques et 3 milliards à la grande distribution qui n’en ont absolument pas besoin.
Nous sommes désormais à gauche dans une bataille entre un modèle social-libéral, et un modèle social-écologique, qui repose les questions fondamentales et refonde le progressisme : quel monde voulons-nous transmettre à nos enfants, le bonheur passe-t-il par une consommation toujours plus grande de biens matériels… Le projet historique de la gauche a consisté à faire grossir le gâteau pour en redistribuer une partie aux plus pauvres. Son logiciel repose sur une croissance forte. Or cette croissance forte est derrière nous et son projet ressemble donc à un canard sans tête... La social-écologie tient au contraire un discours de vérité sur le fait qu’une croissance infinie dans un monde fini n’est pas possible et en tire les conséquences en se donnant comme objectif d’augmenter l’intensité en emplois de l’économie et en développant l’économie du care et la transition écologique, qui revient à remplacer de l’énergie et du capital par du travail humain. Une économie qui privilégie les liens plus que les biens matériels jetables, largement importés et symboles d’un système économique destructeur de notre planète, est une économie créatrice d’emplois locaux, non délocalisables. C’est sur cette base que nous voulons refonder un contrat majoritaire.
C’est un beau débat d’idées, comme on n’en a pas eu depuis longtemps à gauche. C’est l’enjeu des mois qui viennent. Cela peut être à court terme, lors du vote du budget, ou à moyen terme, d’ici les élections de 2017. Peut-être faudra-t-il passer par cette phase d’entêtement dans laquelle le gouvernement est actuellement, qui nous mènera sans doute à l’échec, pour ouvrir un autre chemin.
Quel est le sens de vos entretiens avec six « vraies gens » ?
Montrer qu’en politique, il n’y a pas ceux qui savent et les autres. Je suis frappé par la déconnexion qui existe entre une partie des élites et le reste de la société. Je pense à ceux qui ont fait l’Ena, parfois comme leurs parents, dont le premier job s’est effectué dans un cabinet ministériel, avant d’aller pantoufler dans une grande entreprise, puis de se lancer en politique, à gauche comme à droite… Je le dis sans démagogie, car il faut des élites, mais ces parcours se ressemblent trop et se déconnectent donc du reste de la société. Dans l’appareil d’État aujourd’hui, il y a très peu de personnes en responsabilité qui viennent d’autres horizons que celui de quelques grandes écoles. C’est un appauvrissement extraordinaire, et les décisions prises sont souvent extrêmement conservatrices, que le pouvoir soit de gauche ou de droite.
En réalité, l’expertise existe dans la société, dans les entreprises, dans les associations, dans les quartiers. Mais cette expertise n’est pas présente à la tête de l’État. C’est aussi pour cela que je ne considère pas spontanément que l’État représente par essence l’intérêt général. J’ai trop vu des décisions se prendre au nom de l’intérêt des grands corps. Un État dont l’intérêt général est capté par des intérêts de corps est un État qui dysfonctionne. La gauche doit agir là-dessus car, bien plus que la droite, elle a besoin d’un État qui fonctionne au service de la société. Une réforme de gauche de l’État passerait par la suppression des grands corps, pour redonner de la diversité dans le recrutement de la haute fonction publique. Celui-ci ne peut pas dépendre de deux filières uniquement, Sciences-Po puis l’Ena ou Polytechnique. Enrichir l’État par la société civile est un vieux combat de l’écologie politique, et de ce qu’on appelait à l’époque la « deuxième gauche ». Il est plus que jamais d’actualité !
Dans la conclusion de votre ouvrage, vous évoquez l’émergence d’une nouvelle « société écologique », en notant l’émergence d’un vote écolo inattendu (plus de 20 % aux européennes) dans un millier de petites communes formant un Y, « qui part des Hautes-Alpes vers le Pays basque d’un côté et le Périgord de l’autre, en passant par l’Isère, la Drôme, l’Ardèche et le Gers ». Qu’en savez-vous précisément ?
Ce « Y écolo », ce sont des territoires où les gens privilégient la qualité sur la quantité, le sens sur la consommation, les circuits courts sur les flux mondialisés, qui sont insérés et fiers de leur ancrage territorial sans être dans le repli identitaire. Ces valeurs-là produisent un vote écologiste à plus de 20 %, dans des communes essentiellement rurales. C’est un nouveau territoire d’ancrage pour nous, en plus de ce qu’il est convenu d’appeler les “bobos” des grandes villes, qui sont parmi les grands producteurs de richesses dans les centres urbains.
Dans le cadre du club de réflexions (Imagine) que nous venons de créer avec Cécile Duflot, Philippe Lamberts et Ska Keller (eurodéputés verts, belge et allemande, ndlr), nous allons analyser cette “nouvelle société”, qui est en train de naître en s’appuyant sur des valeurs écologiques. Comme l’attachement au bien commun plutôt qu’aux biens matériels, l’importance donnée à une alimentation de qualité, la volonté de reprendre son destin en main et non d’être un pion de la consommation, la volonté de donner du sens à son activité économique en créant des entreprises sociales, des produits verts ou en développant l’économie sociale et solidaire... Le socle de cette écologie repose sur trois piliers : le « care » (le soin, le bien des personnes), le « dare » (l’audace, la culture de l’initiative et la prise de responsabilité) et le « share » (le partage, l’économie collaborative et durable…).
Ne faites-vous pas comme pour le FN avec le périurbain ? Vous découvrez un territoire un peu marginalisé où se dégage un nouvel électorat, mais qui était celui qui vivait en banlieue avant de s’en éloigner, en l’occurrence les centres-villes pour vous…
Dans les campagnes, l’immense majorité des habitants en milieu rural ne sont plus des ruraux d’origine. Mais si vous avez en tête des néo-ruraux “babas cool façon Larzac”, ça ne représente pas 20 % à 30 % de l’électorat ! Il y a donc autre chose qui se passe, et un nouveau système de valeurs qui se crée. Ce sont des territoires qui créent des emplois, et du lien social, où naissent des maisons des services publics, de l’économie collaborative, des services aux personnes, de l’innovation sociale. Bref une nouvelle façon de faire société, positive et optimiste !
Concernant le périurbain, qui est notre angle mort électoral avec les plus de 65 ans, mon analyse est que c’est précisément l’absence de réponses écologiques qui est la cause du mal-vivre dans ces territoires : étalement urbain mal maîtrisé, absence d’alternative à la voiture, dépendance face à l’augmentation irréversible des prix de l’énergie, défaillances du maillage des services publics… Aujourd’hui, des millions de Français s’y retrouvent piégés, dans un mode de vie qu’ils n’ont pas forcément choisi. L’absence de politiques écologiques les a “insécurisés”. L’écologie pourrait les protéger.
Ce « vivier électoral » est-il en relation avec une implantation militante, ou est-ce un effet de ces militances de « l’après-croissance » (lire notre article) qui s’organisent sans les partis, et du coup votent EELV malgré l’absence de campagnes de terrain de votre part ?
Les bons résultats ne dépendent pas de l’existence, ou non, d’un groupe écologiste local. Les mauvaises langues diront même qu’il vaut mieux qu’il n’y en ait pas ! C’est l’adhésion à un système de valeurs qui conduit au vote écologiste. Et c’est la plus belle motivation !
Le dernier entretien de votre livre est pour un militant des quartiers populaires, Adil El Ouadehe (du collectif Stop contrôle au faciès). Les positions de l’écologie politique pourraient vous permettre d’avoir une bonne audience dans ces zones (laïcité ouverte, lutte contre les discriminations, droit de vote des étrangers, voire légalisation du cannabis). Comment faire pour que cet électorat fasse encore confiance à la gauche en général, et aux écologistes en particulier ?
Nous sommes de plus en plus présents sur le terrain. EELV est par exemple en progression en Seine-Saint-Denis, mais nous manquons de leaders. C’est notre responsabilité aujourd’hui de travailler avec cette nouvelle classe moyenne qui émerge des quartiers, issue des deuxième et troisième générations d’immigrés d’Afrique et du Maghreb. Ils ne se vivent pas comme des victimes, ont plutôt réussi dans leurs études, mais ne sont représentés nulle part. Nulle part dans les médias, dans le monde économique ou dans le monde politique.
L’écologie politique, c’est par définition l’identité multiple, locale et globale, citoyen d’ici et citoyen du monde. Soit on assume enfin que la France est un pays d’immigration et que notre histoire est riche de sa diversité. Soit on s’enferme dans la négation de cette réalité et on laisse alors le champ libre à une vision figée de notre identité qui ne profite in fine qu’au Front national. Sur ce sujet comme sur d’autres, la bataille idéologique est fondamentale. Et la gauche aujourd’hui incarnée par Manuel Valls a trop tendance à se taire, en se disant que la bataille est perdue. Je crois au contraire qu’il est fondamental de la mener et qu’une grande partie de la société française n’attend que ça.
BOITE NOIREL'entretien a eu lieu dans les locaux de Mediapart, le 2 septembre. Il a duré une heure et a été amendé sur la forme par Pascal Canfin.
A lire aussi sur le blog de Tuxicoman : WordPress 4.0