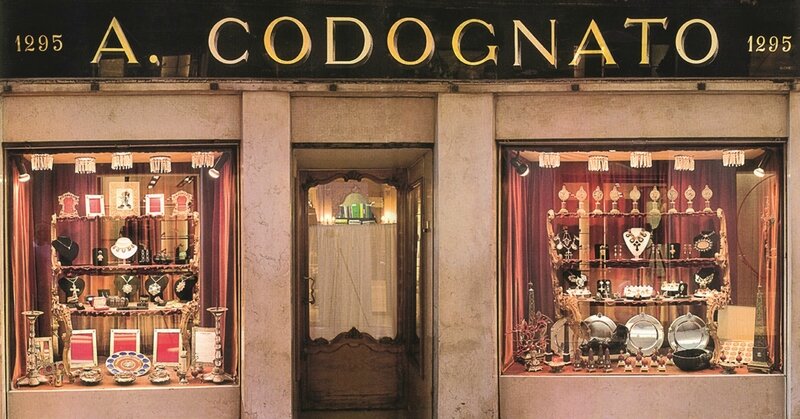Le chômage poursuit son inlassable progression, acculant un peu plus le gouvernement. Nouvelle hausse en juin après la forte augmentation du mois dernier, l'un des plus mauvais mois de l'année avec 30 000 chômeurs en plus. De nouveau, les seniors sont en première ligne et un peu moins, cette fois-ci, les jeunes, très ciblés par le gouvernement. Près de 10 000 nouveaux demandeurs d'emplois de catégorie A (9 400) soit 3 662 100 personnes qui n'ont pas du tout travaillé dans le mois en France. Le pays compte 5 343 100 chômeurs (catégories A, B, C), sans compter les catégories D et E ainsi que tous ceux qui échappent aux statistiques officielles (le halo du chômage). Les chiffres de la Dares (que vous pouvez consulter ici) ont été dévoilés ce vendredi 25 juillet, deux jours après l'adoption des premières mesures du « pacte de responsabilité », la nouvelle arme anti-chômage du gouvernement. Pour stabiliser la courbe du chômage, à défaut d'avoir réussi à l'inverser, l'exécutif parie exclusivement sur ces quarante et un milliards d'euros d'allègement du coût du travail offerts aux entreprises sur le dos de la Sécurité sociale, des ménages, des collectivités locales, tous astreints à une cure de cinquante milliards.
Illusoire ? Le « pacte de responsabilité » ne redressera pas la France. Pour l'heure, les négociations dans les branches sont poussives. Seule une trentaine de branches sur plusieurs centaines ont commencé à discuter des contreparties en matière d'emploi, de formation, d'investissement. Un seul accord a été signé dans l'industrie chimique, prévoyant la création de 47 000 emplois d'ici à 2017. La CFDT et la CFTC l'ont approuvé, pas les autres syndicats, qui estiment que les recrutements promis ne correspondent qu'au rythme actuel de la branche. C'est dire le chantier complexe à mettre en branle avant de ressentir d'hypothétiques frémissements.
Qui plus est, le lien entre exonérations de cotisations sociales et emploi n'a jamais été démontré. L'efficacité de ce dispositif est même plus que mise à mal par de nombreux économistes et travaux empiriques (lire ici notre article). Récemment et dans l'indifférence générale, c'est un rapport venu du Sénat qui devait torpiller l'outil numéro un des politiques pour l'emploi depuis plus de vingt ans. Sauf qu'il ne sera pas publié officiellement, retoqué par les sénateurs de droite et socialistes (lire ici notre article dans lequel nous le publions). On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif et qui voit dans les baisses de “charges”, ces milliards d'euros sans contreparties au coût prohibitif pour l'État, la solution universelle des problèmes économiques se trompe.
Deux nouvelles études viennent le démontrer. Celles de trois chercheurs dont deux sont associés au centre d'études de l'emploi (CEE) : Nadine Levratto du laboratoire EconomiX sous la tutelle du CNRS et de l'université de Paris-X Nanterre, Aziza Garsaa doctorante (PSE université de Paris-I Panthéon Sorbonne et EconomiX, CNRS-université de Paris Ouest Nanterre) et Luc Tessier enseignant-chercheur (ERUDITE, université de Paris Est-Marne-la-Vallée).
La première étude (à télécharger ici ) porte sur les effets des exonérations sur la croissance des établissements industriels en France de 2004 à 2011, la seconde (à télécharger là) concerne les allègements de charges dans les départements d'Outre-Mer (DOM) sur la même période. Particularité de cette dernière : elle a été commandée par la délégation générale de l'Outre-Mer du ministère des Outre-mer. Et elle ne sera certainement jamais rendue publique « compte-tenu de nos conclusions qui incitent fortement à relativiser l'impact des exonérations sur l'emploi ». Entretien avec l'une des auteures, Nadine Levratto.
Vous avez mené deux études sur les exonérations sociales accordées aux entreprises de 2004 à 2011, l'une en métropole, l'autre dans les départements d'Outre-mer (DOM) où elles sont encore plus massives. Elles démontrent une nouvelle fois l'impact sur l'emploi très limité des allègements de cotisations…
Les travaux que nous avons menés mesurent la relation entre le taux d'exonération de cotisations sociales patronales et la création d'emplois dans les établissements en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer (une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante d'une entreprise). Nous travaillons principalement à ce niveau car les exonérations s’y appliquent. Les résultats obtenus montrent que, globalement, les exonérations ont un effet positif sur l'emploi. Cette tendance moyenne générale cache cependant des différences qui conduisent à relativiser l'effet bénéfique de ces dispositifs, voire à s'interroger sur leur efficacité.
En effet, nous avons différencié l'effet du taux d'exonération en fonction du rythme de croissance des établissements. Cette distinction est importante car, en France, comme à l'étranger d'ailleurs, la plupart des entreprises ont un nombre de salariés extrêmement stable dans le temps. Leur taux de croissance est tout simplement égal à zéro. Seule une minorité d’entreprises créent ou détruisent des emplois. L'important est donc de trouver des moyens qui empêchent la suppression d'emplois et favorisent leur création. Pour juger si les exonérations de cotisations sociales remplissent cette fonction, nous avons estimé leur effet selon le taux de variation de l'emploi observé d’un trimestre et d’une année à l’autre. Nos conclusions sont unanimes.
Quelle que soit la population analysée, nos travaux montrent que les exonérations produisent essentiellement leur effet dans les entreprises en croissance. En d'autres termes, les entreprises qui tirent avantage de la baisse du coût du travail liée aux exonérations sont celles qui parviennent à saisir les opportunités de croissance et à s’adapter aux tendances du marché. En revanche, les entités dont l’effectif reste identique ou diminue profitent beaucoup moins de ces dispositifs. On peut donc considérer que les exonérations facilitent la création d’emplois dans les entités qui vont bien, plus qu’elles ne permettent de créer des emplois dans les établissements qui stagnent ou de limiter les destructions d’emplois dans les établissements qui ont des difficultés.
Cependant, l’ampleur de ces effets dépend aussi des caractéristiques propres des entreprises et des établissements. La taille et le secteur d’activité conditionnent fortement l’effet de l’allègement du coût du travail. Il atteint son niveau le plus élevé dans les entreprises et les établissements de grande taille, et dans ceux qui opèrent dans le tertiaire (commerce et services). Les PME, initialement ciblées par ces dispositifs, et l’industrie, plus exposée à la concurrence, sont moins impactées par les allègements du coût du travail.
Ces résultats sont robustes. Ils sont en effet validés pour la métropole et l’outre-mer, lorsqu’on réalise des estimations spécifiques par secteur et par classe de taille et que l’on raisonne au niveau annuel ou trimestriel.
Malgré une abondance d'exonérations de charges depuis des décennies, les DOM, ces départements lointains dont personne ne parle, s'enkystent dans un chômage de très longue durée avec des taux très supérieurs à la métropole, pouvant atteindre jusqu’à 80 % chez les jeunes de moins de 25 ans. N'incarnent-ils pas, à eux seuls, l'échec de cette politique “pour l'emploi” ?
Au regard du marché du travail, les DOM se distinguent par un taux de chômage élevé dont le taux de variation suit, de manière atténuée, celui observé en métropole, des écarts de salaires avec la métropole variables selon les catégories socio-professionnelles (plus élevés pour les cadres, les professions intermédiaires et les employés, plus faibles pour les ouvriers qualifiés et non qualifiés), un taux d’occupation structurellement faible (de 32 % à 42 %) en raison d’un taux de chômage élevé et d’une forte proportion d’inactifs.
Afin de réduire les difficultés d’accès au marché du travail et les freins à l’embauche, les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs spécifiques aux départements d’outre-mer. À côté des contrats aidés, essentiellement destinés au secteur non marchand, la politique de l’emploi s’est particulièrement appuyée sur des dispositifs spécifiques d’exonération de cotisations sociales patronales dont la compensation de l’État aux organismes de sécurité sociale représente environ la moitié des crédits de la Mission outre-mer. Ce régime spécifique a été mis en place par la « loi tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer » du 25 juillet 1994, dite loi Perben, au moment de l'alignement progressif du salaire minimum domien sur celui en vigueur en métropole. Il a ensuite fait l’objet de plusieurs modifications. En 2001, par la loi d'orientation pour l'outre-mer (Loom), en 2003, par la loi de programme pour l'outre-mer (Lopom, également appelée loi Girardin) et en 2009, par la loi pour le développement économique de l'outre-mer (Lodéom). Cette dernière prévoit des dispositifs d’exonération dégressifs jusqu’à 2,8 SMIC pour le régime général (avec des variantes selon que les entreprises emploient moins ou plus de 11 salariés) et jusqu’à 4,5 SMIC pour le régime renforcé. De nouveaux seuils d’exonération sont applicables, en 2014, pour les entreprises susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE).
Les exonérations outre-mer représentent plus d’un milliard d’euros par an. En 2012, elles ont progressé de 4,9 % en lien avec la hausse de la masse salariale dans ces départements.
Les travaux que nous avons réalisés portent sur la période 2004-2011. Ils montrent que les taux d’exonération apparents médians sont proches de 30%. Dans les 10 % d’établissements les moins exonérés, ils sont passés de 10 à 5% entre 2007 et 2010 alors qu’ils sont passés de 66 à 58 % dans les 10 % d’établissements les plus fortement exonérés. Ils sont particulièrement élevés dans l’industrie manufacturière (y compris les IAA), la construction, le transport et l’hébergement et la restauration.
Le premier résultat est donc que les exonérations de cotisations sociales patronales contribuent globalement à réduire le coût du travail. Nous montrons aussi que la baisse des taux d’exonération liée à l’entrée en vigueur de la Lodéom s’est accompagnée d’un maintien de l’emploi dans la majorité des établissements observés, alors même que les économies entraient dans la crise. L’impact des exonérations et l’intensité de leur recours par les entreprises sur l’emploi varie également selon la dynamique propre à l’établissement. Les exonérations tendent davantage à stabiliser l’emploi dans les établissements qui réduisent le nombre de salariés qu’à intensifier les embauches dans les établissements qui sont sur des trajectoires ascendantes. Cette tendance générale admet cependant de nombreuses exceptions suivant les secteurs d’appartenance et la taille des établissements considérés. Les exonérations produisent leurs principaux effets dans les secteurs de l’industrie et parmi les grandes entités de plus de 50 salariés. La croissance de l’emploi dans les petits établissements et pour les secteurs les plus exonérés (hébergement et restauration et commerce) est en revanche peu, voire pas, déterminée par les taux d’exonération appliqués.
Quelle a été votre méthodologie ?
Nous avons estimé dans quelle mesure les établissements réagissent à une baisse globale du coût du travail mesurée par le total des exonérations de cotisations sociales patronales rapporté à la masse salariale grâce à un modèle de variation de l’emploi de la firme bien connu des économistes industriels. Il permet de mettre en relation la variation de l’emploi des établissements et le taux d’exonération apparent (montant des cotisations rapporté à la masse salariale) en tenant compte de caractéristiques telles que la taille, le secteur, la période, etc.
Nous avons également mobilisé une technique d’estimation novatrice, qui permet de tenir compte à la fois des effets individuels et des effets temporels et ce pour les différents niveaux de variation de l’emploi observés dans les populations étudiées.
Pour réaliser nos estimations, nous avons mobilisé quatre sources de données : des fichiers fournis par l’ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité Sociale), les données CLAP (Connaissance locale de l’appareil productif) de l’INSEE, le REE (Répertoire des entreprises et des établissements) de l’INSEE, et la base comptable DIANE du bureau van Dijk, à partir desquelles nous avons constitué plusieurs panels composés d’entités actives durant la période 2004-2011. Chaque panel compte plusieurs milliers d'établissements et est représentatif de l'ensemble de l'économie française métropolitaine ou ultramarine. Une thèse en cours procède à l'estimation de modèles sur la base de panels de plus de 100 000 entreprises et établissements.
Au total, des dizaines de milliers de données portant sur la période 2004-2011 ont été mobilisées pour réaliser ce travail.
Pourquoi une telle addiction de la part des gouvernements aux exonérations de charges sociales, devenues un dogme à droite comme à gauche alors que leur impact sur l'emploi et la courbe du chômage sont quasi nuls ?
L’instauration des dispositifs visant à réduire le coût du travail grâce à une exonération des cotisations sociales patronales date des années 1990. En réponse à une hausse ininterrompue du taux de chômage, elles n'ont cessé d'être étendues depuis. À l’origine, les tenants de ces politiques ont souligné le fait que les travailleurs les moins qualifiés étant les plus touchés par le chômage et les moins productifs, ces mesures devaient être ciblées sur les bas salaires. Avec le temps, l’assiette et le taux n’ont cessé de s’étendre, l’année 2008 marquant un coup d’arrêt. Aujourd’hui, avec le CICE, on repart à la hausse. L’ACOSS a calculé qu’en 2012, les exonérations représentaient 27,6 milliards d’euros, dont près de 1,2 pour les départements d’outre-mer.
L’adhésion quasi généralisée aux politiques d’exonérations reposent sur l’idée que le facteur travail coûte trop cher, que les travailleurs peu qualifiés sont insuffisamment productifs au regard des salaires qu’ils reçoivent et que la réduction du coût du travail va améliorer la compétitivité des entreprises et, donc, leur permettre de créer des emplois. Ce discours repose sur une approche très mécanique du fonctionnement du marché du travail : la décision d’embauche repose sur le prix rapporté à la productivité. S’il est trop élevé, les entreprises sont dissuadées d’embaucher et sont pénalisées par des coûts de production (et donc des prix de vente) non compétitifs. Les exonérations permettraient alors de corriger ce déséquilibre et de favoriser l’emploi par un double effet. Un effet de substitution dans la mesure où les entreprises vont être incitées à embaucher les employés dont le coût du travail est devenu plus attractif et un effet volume car la baisse des coûts de production se répercute sur les prix si bien que la demande qui s’adresse aux entreprises concernées par les exonérations augmente, ce qui favorise l’embauche. Certains ajoutent un effet de compétitivité internationale. Au bout du compte, les exonérations de cotisations sociales sont supposées favoriser la création d’emplois et sont donc présentées comme un dispositif efficace de lutte contre le chômage.
Ce point de vue s’est imposé dans le paysage alors même que les travaux empiriques qui le confortent ont fait l’objet de nombreuses critiques et que des contradictions existent parmi les travaux qui concluent à leur caractère bénéfique.
Comment le caractère incontournable des exonérations de cotisations sociales a-t-il pu si profondément s’installer dans l’espace public français ? C’est assez mystérieux, d’autant que la comparaison du coût du travail dans l’industrie, il faut le rappeler, n’est pas préjudiciable à la France. Selon le Bureau of Labor Statistics, le coût horaire du travail dans l’industrie, en 2012, était de 39,8 dollars en France, un niveau très proche de celui des États-Unis (35,7 dollars) et nettement plus faible que celui de l’Allemagne (45,8 dollars). Les écarts deviennent défavorables à la France lorsqu’on calcule une moyenne nationale prenant en considération les secteurs de la banque et de l’assurance qui tirent la moyenne vers le haut. L’enquête européenne sur le coût de la main-d’œuvre 2008 d’Eurostat, utilisée par Bertrand Marc et Laurence Rioux dans l’étude « Le coût de la main-d’œuvre : comparaison européenne 1996-2008 » (INSEE, Emplois et salaires, 2012), confirme ces tendances.
Depuis 10 ans, les coûts salariaux unitaires français (salaire par unité produite) ont évolué comme la moyenne européenne. L’écart du coût du travail entre la France et les pays concurrents n’épuise donc pas les explications de la désindustrialisation, des licenciements ou de la dégradation du solde du commerce extérieur. Or, l’idée d’une baisse du coût du travail comme solution universelle aux problèmes économiques a néanmoins fini par s’imposer.
Cette politique de court terme s'est aujourd'hui installée dans la durée. Le gouvernement s'appuie désormais exclusivement sur le CICE et le pacte de responsabilité pour lutter contre le chômage. À chaque fois, une focalisation excessive sur le coût du travail. Le débat n'est-il pas à côté de la plaque ?
C’est une vraie question. L’explication en vogue est que le coût excessif du travail est la cause du déficit de compétitivité des entreprises françaises. Ce constat dressé, il est fatal que les différents gouvernements œuvrent pour l’alléger. La politique actuellement suivie s’inscrit donc bien dans ce registre. Le CICE, suivi du pacte de responsabilité et augmenté de quelques mesures supplémentaires de soutien à l’activité des entreprises, va représenter une dépense fiscale d’environ 41 milliards d’euros au bénéfice des employeurs. Dans la mesure où tous les pays d’Europe adoptent cette même politique, il n’est pas étonnant que l’on entre dans une spirale déflationniste dont les remèdes pour en sortir consistent essentiellement dans le renforcement de ceux qui ont contribué à la créer.
Une alternative est pourtant possible, mais ne parvient pas à trouver sa place dans le débat public. Quelques voix s’élèvent en effet pour souligner l’importance de la compétitivité hors-prix, liée à la qualité des produits, à leur degré de nouveauté, leur spécificité, etc., leur portée reste limitée. Dans ce domaine, la France est pourtant bien loin du sacro-saint modèle allemand : la R&D plafonne à 2,1 % du PIB en France contre 2,8 % en Allemagne. Ce différentiel est encore plus marqué si l’on considère les dépenses en R&D du secteur privé qui, en 2008, atteignaient 31 milliards d’euros en Allemagne contre 15 en France. L’innovation est pourtant un moteur de la performance des entreprises, comme le montre l’évolution comparée de la productivité des facteurs qui a diminué de 2 points entre 1999 (base 100) et 2012, alors que, parallèlement, elle augmentait de 8 points en Allemagne.
La spécialisation du modèle industriel français dans un niveau moyen de gamme des produits a rendu les entreprises plus vulnérables aux variations de prix que ne le sont leurs concurrents ou homologues allemands. Ces derniers se sont partiellement affranchis des contraintes de coût par un positionnement sur des segments de marché haut de gamme et innovants. Comme l’avaient montré Salais et Storper dans leur ouvrage de référence, Les Mondes de Production, sur ces marchés, la coordination entre acteurs s’opère par la qualité plus que par les prix.
L’argument de la baisse du taux de marge pour expliquer le recul de la position des entreprises françaises en matière d’innovation ne tient pas si l’on considère d’une part, que la hausse du taux de marge des entreprises entre 1994 et 2002 n’a pas été accompagnée d’une hausse des dépenses de R&D et d’autre part, que les dividendes ont considérablement augmenté sur la dernière décennie. Bilan de l’affaire, les dépenses en R&D qui représentaient 44 % des dividendes en 1992, n’en représentent plus qu’environ 25 % aujourd’hui.
A lire aussi sur le blog de Tuxicoman : Egypte, Syrie, Ukraine, Palestine… toujours rien.