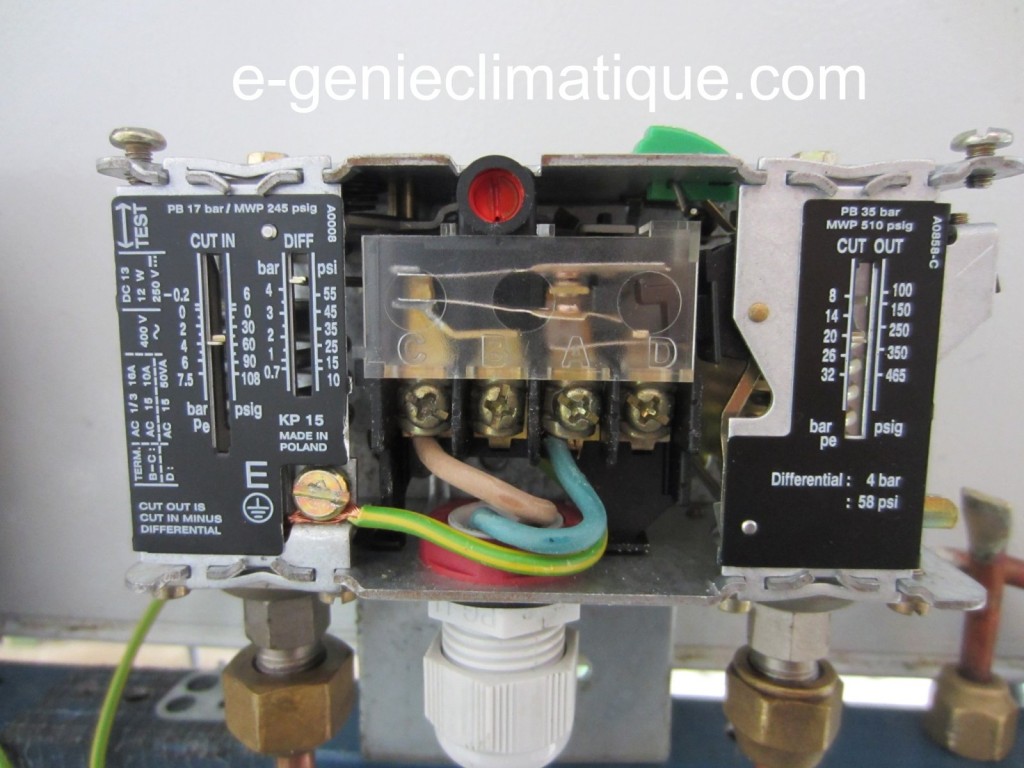Généralement par civisme, parfois par intérêt ou faute de choix, ils ont tiré la sonnette d’alarme pour alerter l’opinion publique. Certains sont médiatisés, d’autres s’en remettent à leur hiérarchie et en subissent parfois les brimades. Des affaires Karachi à Cahuzac, en passant pas le Mediator, l’actualité a mis en lumière des employés dénonçant des actes de fraudes, parfois extrêmement graves. À Paris, un colloque organisé par l’ONG anti-corruption Transparency International France était consacré, jeudi 4 juillet, à la question de ces lanceurs d’alerte.
« Je n’ai jamais cherché à être un lanceur d’alerte. Je n’ai jamais enquêté, je suis juste tombé sur quelque chose de trop gros », sans s’étendre sur les détails de son affaire, dans une salle comble de l’Institut catholique de Paris, un des spectateurs raconte le basculement de se vie. « Lorsque j’ai reçu le référé pour diffamation, cela m’a fait rire. C’était un acte civique, j’étais certain que la justice me protégerait. L’audience même était une comédie absurde. Je n’aurais jamais cru que je serais condamné, je n’aurais jamais pensé qu’ils ruineraient ma vie, qu’ils me feraient perdre mon cabinet, tout ce que j’avais. »
Dans l’assistance, quelques hochements de tête. Ils sont nombreux à être passés par là. Cadres du secteur bancaire, fonctionnaires, professions libérales, tous ont été amenés à dénoncer des pratiques frauduleuses, parfois dangereuses, dont ils ont été témoins. Tous ont vu leur vie basculer : harcèlement, mise au placard, licenciement, procès, isolement.
« La France est ce pays paradoxal où un ministre du budget pratique la fraude fiscale, mais où un commandant de police est révoqué pour avoir signalé un usage illicite de fichiers par son administration », relève Nicole Marie Meyer, experte de l’alerte éthique chez Transparency International et auteur d’un récent rapport sur le sujet. Depuis 2008, les (seuls) salariés du secteur privé sont protégés de représailles professionnelles, mais dans le seul cas de dénonciation de faits de corruption. Un panel de situations n’est ainsi pas couvert : conflits d’intérêts, abus de pouvoir, fraude.
Quant aux fonctionnaires, ils sont tenus de signaler “crimes et délits” (article 40 du code de procédure pénale) mais ne disposent d’aucune protection. « Une bizarrerie internationale », commente Transparency International, dans un rapport sur les 27 pays de l’Union européenne.
L’affaire du Mediator en 2010 et les récents scandales politiques et financiers ont fait prendre conscience du problème au législateur. Trois projets de lois visent à corriger le tir : le premier sur la transparence de la vie publique doit protéger les salariés dénonçant des situations de conflit d’intérêts, le deuxième sur la fraude fiscale concerne les lanceurs d’alertes pour des “faits constitutifs d’une infraction pénale”, et enfin un texte sur le statut des fonctionnaires, prévu pour la rentrée, complétera l'article 40.
La semaine dernière, la commission des lois du Sénat qui examinait le projet de loi sur la transparence de la vie publique a cependant supprimé l’article relatif aux lanceurs d’alerte, au prétexte de redondance avec le projet de loi contre la fraude fiscale. Celui-ci ne concerne pourtant que les faits de corruption. Exit, donc, les conflits d’intérêts. Sept organisations, parmi lesquelles Transparency International et Sherpa ont fait part dans un communiqué de leur « incompréhension », appelant les sénateurs à « revenir sur cette suppression et à réaffirmer leur volonté de protéger ceux qui n’ont comme seule motivation que de faire leur devoir de citoyen ». Quant aux lois déjà votées (ici et là), elles n’ont toujours pas eu de décret d’application.
Transparency International s’inquiète de ce millefeuille juridique et de la création d’instances qui auraient tout l'air de coquilles vides. Elle recommande une loi globale pour salariés du public comme du privé, une définition plus détaillée des faits visés et des représailles encourues ainsi que la création d’une « autorité indépendante : agence de corruption ou bureau d’alerte », dotée de moyens d'investigation réels. « Compte tenu de l’absence de tout appui institutionnel aux lanceurs d’alerte, une fondation caritative devrait être créée, estime en outre la spécialiste Nicole Marie Meyer, cette fondation ne pourra être que le fruit d’une maturation de la société civile, prenant conscience du soutien nécessaire à apporter à ces éveilleurs de conscience. »
Le modèle anglais
Un tel organisme existe en Angleterre depuis déjà vingt ans. Fondé après une série de catastrophes en 1993, Public Concern at work a joué un rôle de conseil et d’accompagnement auprès des lanceurs d’alerte mais aussi de lobby, poussant le Parlement britannique à adopter une loi globale sur le sujet dès 1998, The Public Interest Disclosure Act. Cette loi, référente en la matière, a été révisée en juin afin, notamment, que les employeurs soient responsables en cas de harcèlement en milieu professionnel entre employés. Autre différence sensible entre cette loi globale et les initiatives françaises : le lanceur d’alerte peut être protégé, qu’il s’adresse à son employeur, à une autorité régulatrice (l’Autorité des marchés financiers, par exemple) ou à la presse.
Depuis sa création, l’association a pu interroger un millier de lanceurs d’alerte. Il en ressort que près d’un sur cinq a été licencié après un signalement et que 16 % d’entre eux déclarent avoir eu des problèmes de santé (dépression, notamment). Très peu d’entre eux se tournent en premier lieu vers les médias.
« Il y a un moment où vos propres collègues, voire vos proches, se retournent contre vous, sur le thème : “Tu t’acharnes parce que tu as été mis au placard”, “tu exagères, tu prends les choses trop à cœur”. Ce genre de réactions est très dur à vivre. On doute, on s’isole, raconte la femme d’un lanceur d’alerte. On n’a pas idée de la machine que peut déployer une grande entreprise. »
Intervenante star du colloque, la pneumologue Irène Frachon a longtemps témoigné de son expérience. Son combat contre les laboratoires Servier dans l’affaire du Mediator a fait la lumière sur les lanceurs d’alerte. « Au moment d’écrire mon livre, je me suis posé la question de l’impact qu’il aurait sur la vie des gens que je devais citer et qui risquaient la prison pour leurs actions. Cela m’a hantée », raconte la médecin. Elle décide finalement d’en mener à bout l’écriture en s’attachant à une narration aussi factuelle que possible.
« Le plus dur a été de découvrir l’insensibilité totale du milieu médical. J’étais persuadée que mon livre les choquerait – on parle quand même de près de 2 000 morts ! – mais pas du tout, c’était "dans l’ordre des choses" », narre Irène Frachon en décrivant les rapports de corruption banale entre industrie pharmaceutique et médecins, qui poussent à détourner le regard. Un homme dans l’assistance parle de la responsabilité des “sachants”, de la nécessité de pouvoir sanctionner une complicité tacite. Selon l’étude de Public concern at work, 60 % des employés signalant une fraude n’obtiennent jamais de retour de leur hiérarchie.
Se considérant comme privilégiée, pour avoir profité du soutien indéfectible de son employeur depuis le début de l’affaire, Irène Frachon n’en a pas moins été éreintée par le laboratoire pharmaceutique : livre retiré des rayons deux jours après sa parution, procès, condamnation… « Soyez rapidement dans la presse pour être protégé, avise la pneumologue. Je peux aujourd’hui m’exprimer librement car je suis visible médiatiquement. Mais d’autres acteurs du dossier continuent à être assignés en justice par Servier. »
A lire aussi sur le blog de Tuxicoman : Le PC est il mort?